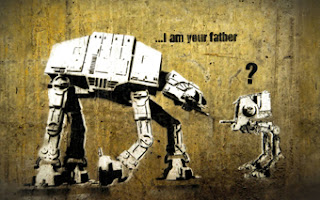Vu ce matin, sur le site de Mad Movies, ce trailer bien sympathique de Gnomes Attack. J'en profite pour signaler le site d'Effective Pictures, qui a posté la vidéo sur Youtube et propose, entre autres choses, de très jolis fonds d'écran (ça devrait plaire à Mr. Patate).
mardi 29 novembre 2011
dimanche 27 novembre 2011
Charles F. Maien : notoriété posthume d'un génie inconnu (Part.4)
Les premières réflexions notées par Charles F. Maien dans son Journal, après son arrivée à Kingsport, trahissent une certaine confusion et une profonde amertume. Le jeune homme semble déçu par son aventure aux Etats-Unis, dont la mentalité, qu'il juge profondément individualiste, ne lui convient absolument pas. Il reproche à Gernsback de l'avoir entrainé dans cette débâcle. Ses projets sont alors arrêtés : demander à ses parents l'argent nécessaire pour payer son billet de retour en Europe et entamer enfin sa carrière d'enseignant. Le 20 juillet, il télégraphie aux éditions Red Books son refus définitif de publier La dernière bataille et sa volonté de mettre un terme à ses ridicules prétentions littéraires. Il ne recevra pour toute réponse qu'un simple accusé de réception.
 | |||||||||||
| Révélations posthumes, Andréas & Rivière |
Maien loue une chambre dans la pension de famille de Martha Gamble, située au nord de la ville, dans le vieux quartier du Hollow, aux pieds de Central Hill. Puisqu'il doit de toutes façons attendre quelques jours avant la réception de son mandat, il décide de profiter de l'opportunité qui lui est offerte de visiter Kingsport. La Cité des brumes, comme la surnomment certains poètes, connait durant la période estivale une affluence considérable de vacanciers qui fuient la chaleur de Providence ou de Boston, pour venir bénéficier des charmes océaniques du petit port de pêche. Bercé par la douceur du climat et l'ambiance festive qui se dégage des ruelles pavées que bordent les majestueuses rangées de bâtisses du 18ème siècle, l'humeur de Maien s'améliore rapidement. A la pension, il rencontre Malcolm Veidt, professeur à Hall School, l'école privée du quartier de South Shore, qui l'accompagne dans ses promenades et lui fait découvrir les aspects plus méconnus et plus ... folkloriques de Kingsport. Ainsi se rendent-ils au 403, Green Lane où se dresse la plus vieille demeure de la ville, que les anciens appellent la Septième Maison sur la Gauche, construite au milieu du 17ème siècle et où aurait vécu, au temps de la chasse aux sorcières, le prêtre d'un culte démoniaque. Un après-midi, Veidt loue une petite embarcation pour les conduire sur l'Ile du Pilote, proche du récif de Jersey qui protège le port des intempéries venues de l'Atlantique, sur laquelle le gardien du phare de North Point prétend voir débarquer d'étranges navires, les nuits de brouillard. Maien se trouve complètement transporté dans cet univers pittoresque où rêve et réalité se mêlent inlassablement à l'écume de l'océan. Sur l'îlot désolé et battu par les vents, tandis qu'il contemple les minuscules toitures à pignons de Kingsport, dominées par le monumental affleurement granitique de Kingsport Head, Maien ressent pour la première fois, depuis son enfance, un sentiment de plénitude. Le lendemain, Charles Maien écrit à ses parents qu'il décale son retour à la fin du mois d'août.
Durant le reste de l'été, Maien, qui connait rapidement la ville comme sa poche, multiplie les escapades dans la campagne et les bourgades environnantes, de Marblehead jusqu'à Rockport. Il noue des liens étroits avec Malcolm Veidt et ses amis de Hall School, avec qui il se retrouve presque tous les soirs autour d'un bon repas chez Dennehy's, avant d'aller finir la nuit au Rope & Anchor, le vieux bar des pêcheurs de Ship Street. Quand il ne part pas en excursion, Maien se rend régulièrement à la Société d'Histoire pour approfondir ses connaissances sur le passé de Kingsport et de Kingsport Head, qui exerce toujours sur lui une incroyable fascination. A la Société d'Histoire, il fait bientôt la connaissance de Barbara Whistler. Cette jeune femme de Providence vient régulièrement à Kingsport où vit sa tante et, comme lui, elle est férue d'histoire locale. Barbara profite de ses vacances sur la côte pour faire quelques dessins du port et du littoral qu'elle revend aux touristes. Entre les deux excentriques, l'entente est immédiate et rapidement Barbara intègre la bande du Rope. A ce rythme, la fin de l'été arrive à grands pas et Maien doit prendre une décision. Un collègue de Veidt lui a proposé un poste de professeur de physique remplaçant au lycée d'Etat de Kingsport. Le contrat doit débuter à la mi-septembre, pour se terminer aux vacances de Noël. Maien écrit à ses parents qu'il accepte l'offre qui lui est faite et retarde à nouveau son départ de quelques mois.
Maien aborde ses nouvelles fonctions d'enseignant avec sérieux et application. Ses rapports avec les élèves et ses nouveaux collègues sont excellents. Du début octobre à la mi-décembre, il travaille également à l'écriture de Laelith, le second roman du Cycle de Zama. Se déroulant plusieurs décennies avant La dernière bataille, il a pour cadre Gibraal, une planète de l'Empire de Roon, dont l'inspiration semble provenir tout droit de Kingsport. Maien décrit un monde recouvert par un océan unique d'où émerge l'Eperon, une gigantesque île-montagne, haute de plusieurs kilomètres, sur laquelle s'est développée toute une civilisation qui mêle harmonieusement pensées spirituelles et scientifiques. L'intrigue se concentre sur Laelith, un prêtre-du-Savoir, à qui l'Empire roon a ordonné de mettre au point des armes susceptibles d'inverser le cours de la guerre contre Karth. Dans sa mission, Laelith se retrouve opposé à Bara, chef du Conseil de Gibraal, qui refuse de voir les connaissances ancestrales de sa planète, mises au service d'une guerre qu'elle juge illégitime. Le peuple de Gibraal choisira finalement de détruire l'Eperon pour priver l'Empire d'un avantage déloyal sur son adversaire et ses survivants, parmi lesquels Laelith et Bara, se disperseront à travers la galaxie. Maien joue à nouveau sur le double tableau des intérêts personnels et politiques, ou plus exactement ici éthiques, sans que jamais l'un des aspects ne vienne affaiblir l'autre. L'histoire d'amour entre Laelith et Bara, qui doit certainement beaucoup à l'idylle naissante entre l'écrivain et Barbara Whistler, ne sombre jamais dans la mièvrerie sentimentale, dont la fantasy est souvent coutumière. Cette romance s'intègre parfaitement à la description minutieuse que Maien livre de la société de Gibraal et aux idées philosophico-théologiques qu'il propose, pour chercher un meilleur équilibre entre des croyances surnaturelles fondamentales, en cela qu'elles permettent d'élargir le champ de notre imaginaire, et une approche matérialiste du monde.
Lorsque l'année 1904 s'achève, Charles Maien a vu son contrat s'étendre jusqu'aux vacances d'été. Il enseignera finalement pendant trois années consécutives au lycée d'Etat de Kingsport. Son équilibre parfaitement retrouvé, il renoue contact avec Hugo Gernsback. L'entreprise new-yorkaise de ce dernier, l'Experimenter Publishing Company, commence à prendre de l'essor. Au printemps 1905, Maien et Barbara viennent lui rendre visite dans la métropole. Les anciennes querelles sont oubliées et Gernsback se réjouit que son ami ait enfin trouvé un « endroit à lui … et quelqu'un pour y vivre avec lui ». En avril, le couple s'installe dans un modeste appartement de Derby Street. Il se marie le mois suivant, dans la très typique église des Marins, sous les auspices du vénérable révérend Alijah Horne et celles de la centaine de plaques commémoratives, dédiées à tous les navires perdus en mer, au large de Kingsport … L'apéritif a lieu au Rope qui se trouve à un pâté de maison de là. Tous les collègues du lycée d'Etat, la famille de Barbara, Veidt et la bande du Rope et bien sûr Gernsback et Rose Harvey (qui se marieront, à leur tour, quelques mois plus tard) sont présents.
Maien vient d'achever un recueil de cinq brèves nouvelles, intitulé Les Ecumeurs, et consacré à la flotte stellaire des pirates du Récif Extérieur, futurs alliés malheureux de Karth, lorsque le 06 juillet 1906, dans une papeterie de Providence, sa route croise, par hasard, celle d'un écrivain en devenir, Howard Phillips Lovecraft.
 |
| Lovecraft by Mike Mignola |
jeudi 24 novembre 2011
mercredi 23 novembre 2011
dimanche 20 novembre 2011
Le seuil des séries
Porte d'entrée souvent négligée de la série TV, son générique n'en reste pas moins un élément crucial, tant par le visuel qu'il propose, que par le choix de la musique utilisée, pour nous donner envie (ou pas) de nous y immerger plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons. Je me suis amusé à sélectionner dix génériques de séries, certaines très récentes, d'autres plus anciennes, que je pourrais qualifier ainsi : "les génériques que même si tu les connais par coeur, tu peux pas t'empêcher de les regarder avant chaque épisode, tellement ils sont bien faits" ...
Game of Thrones
Destiné à faire entrer progressivement le spectateur dans l'univers médiéval-fantastique des Sept Royaumes, imaginé par l'écrivain George R. R. Martin, le générique de Game of Thrones s'ouvre sur le passage de l'astre solaire, entouré par une machinerie en forme d'anneaux qui évoque les anciens planétaires de la Renaissance. Ce premier symbole vient d'emblée souligner le rôle capital joué par le Soleil, dans un monde qui ne connait que deux saisons pouvant durer plusieurs décennies : un été de prospérité et un hiver source d'une terrible menace, puisqu'il est favorable à ceux que l'on appelle "les Autres", des êtres légendaires vivant au-delà d'un Mur gigantesque, situé au Nord du continent. La caméra survole ensuite une carte des différents royaumes en présence, dont les capitales respectives se déploient, au fur et à mesure, par un jeu complexe de rouages et d'engrenages, métaphore des machinations mises en place par chaque famille pour conquérir le pouvoir. On notera que le générique évolue, tandis que les épisodes dévoilent de nouveaux territoires, en les intégrant à la carte. Ainsi, le générique du 1er épisode ne présente-t-il que Port-Réal (siège des Sept Royaumes), Winterfell (château de la famille Stark), Châteaunoir (siège des Gardes de la Nuit, défenseurs du Mur) et Pentos (une cité-libre du continent d'Essos). Ajoutons enfin que le nom des acteurs se trouve toujours associé au blason de la famille à laquelle appartiennent leurs personnages.
Ce petit bijou de précision a été réalisé par Angus Wall et sa société Elastic, déjà à l'origine du somptueux générique de la série Rome. La musique est signée Ramin Djawadi, membre du studio Media Ventures, fondé par Hans Zimmer, studio dont les orchestrations caractéristiques ont illustré des films comme Gladiator, Le roi Arthur ou Kingdom of Heaven ... Pas toujours subtil, mais forcément épique !
Game of Thrones
Destiné à faire entrer progressivement le spectateur dans l'univers médiéval-fantastique des Sept Royaumes, imaginé par l'écrivain George R. R. Martin, le générique de Game of Thrones s'ouvre sur le passage de l'astre solaire, entouré par une machinerie en forme d'anneaux qui évoque les anciens planétaires de la Renaissance. Ce premier symbole vient d'emblée souligner le rôle capital joué par le Soleil, dans un monde qui ne connait que deux saisons pouvant durer plusieurs décennies : un été de prospérité et un hiver source d'une terrible menace, puisqu'il est favorable à ceux que l'on appelle "les Autres", des êtres légendaires vivant au-delà d'un Mur gigantesque, situé au Nord du continent. La caméra survole ensuite une carte des différents royaumes en présence, dont les capitales respectives se déploient, au fur et à mesure, par un jeu complexe de rouages et d'engrenages, métaphore des machinations mises en place par chaque famille pour conquérir le pouvoir. On notera que le générique évolue, tandis que les épisodes dévoilent de nouveaux territoires, en les intégrant à la carte. Ainsi, le générique du 1er épisode ne présente-t-il que Port-Réal (siège des Sept Royaumes), Winterfell (château de la famille Stark), Châteaunoir (siège des Gardes de la Nuit, défenseurs du Mur) et Pentos (une cité-libre du continent d'Essos). Ajoutons enfin que le nom des acteurs se trouve toujours associé au blason de la famille à laquelle appartiennent leurs personnages.
Ce petit bijou de précision a été réalisé par Angus Wall et sa société Elastic, déjà à l'origine du somptueux générique de la série Rome. La musique est signée Ramin Djawadi, membre du studio Media Ventures, fondé par Hans Zimmer, studio dont les orchestrations caractéristiques ont illustré des films comme Gladiator, Le roi Arthur ou Kingdom of Heaven ... Pas toujours subtil, mais forcément épique !
Les Mystères de l'Ouest
Conçu par Ken Mundie pour la DePatie/Freleng Enterprises, à qui l'on doit la célèbre ouverture de La Panthère rose, le générique des Mystères de l'Ouest (The Wild Wild West) parvient, en moins d'une minute, à exploiter tous les clichés du western et à synthétiser l'esprit de la série. Il se présente sous la forme d'une planche de bande dessinée, découpée en cinq cases qui vont s'animer en autant de saynètes, au style très cartoon. Cet aspect se trouve renforcé par l'excellente musique de Richard Markowitz (Les Envahisseurs, Hawaï, police d'état) qui vient par moment illustrer les saynètes à la manière d'un bruitage.
Les cases s'éclairent et s'animent donc successivement pour interagir avec le personnage central, un Cowboy à l'attitude désinvolte qu'on suppose être James West, le héros de la série. Celui-ci commence par allumer un cigare avec une allumette qu'il jette négligemment hors de sa case (1er cliché), avant de se mettre à marcher, de profil, vers la droite. Une seconde case s'anime alors et montre un voleur sortir d'une banque, un sac de billets sur l'épaule (2nd cliché), que le Cowboy maîtrise par une prise de karaté (renvoi aux nombreuses scènes de bagarres qui ont contribué à la popularité de la série). Dans la 3ème case, une main s'apprête à sortir un as de pic de la boucle d'une botte, vraisemblablement pour tricher pendant une partie de poker (3ème cliché). Le Cowboy pointe son pistolet vers elle et arrête l'action du tricheur (renvoi à la mission de justice et de maintien de l'ordre des héros), avant d'être lui-même mis en joue par la main armée de la 4ème case, dont il se débarrasse à l'aide d'un Derringer caché dans sa manche (renvoi aux multiples gadgets conçus par Artemus Gordon). Le Cowboy s'appuie ensuite, bras croisés, contre le bord de sa case. D'un coup d'ombrelle, la jeune femme, fort apprêtée, de la dernière case (clichés de l'entraîneuse de bar, de la prostituée et/ou de l'espionne) fait tomber le chapeau du Cowboy. Il l'attire vers lui pour l'embrasser. La jeune femme en profite pour sortir un couteau, mais le Cowboy la met k.o. par un puissant crochet à la mâchoire (renvoi au succès du personnage auprès de la gente féminine et à son machisme ... frappant. On notera que le titre original de la série, The Wild Wild West, peut être aussi bien compris comme une référence à l'"Ouest sauvage" qu'à "West le violent"). Le Cowboy s'éloigne vers le fond de la page dont l'ensemble des cases, désormais toutes éclairées, forme le drapeau américain (James West et Artemus Gordon sont agents des services secrets). Enfin, la planche de bande dessinée disparaît pour laisser la place à un train à vapeur (cliché de la conquête de l'Ouest et renvoi au train privé qui sert de quartier général aux héros).
Charles F. Maien : notoriété posthume d'un génie inconnu (Part.3)
Durant l'été 1904, Hugo Gernsbach, dont le brevet pour la pile sèche n'a toujours pas été délivré, se lance dans une nouveau projet : la commercialisation de sa radio portative. Ne trouvant pas les pièces dont il a besoin en Amérique, il doit les importer d'Allemagne. Le jeune chef d'entreprise ayant déjà touché une avance confortable sur de futures commandes et les pièces ne devant pas arriver d'Europe avant plusieurs semaines, il propose à Charles F. Maien de les accompagner, lui et sa fiancée Rose Harvey, pour de petites vacances en Nouvelle-Angleterre.
Depuis le mois de mai, l'accueil réservé à la nouvelle Les Généraux s'avère plutôt bon, à en juger par le courrier des lecteurs d'Electric Stories. Un petit éditeur de Brooklyn, Red Books, se dit prêt à publier La dernière bataille, à condition que l'auteur accepte d'y apporter quelques modifications et d'y ajouter une cinquantaine de pages. A nouveau, Maien est déchiré entre le désir de voir son travail livré à l'appréciation du public et sa volonté de ne pas soumettre sa création au diktat d'un éditeur. Son état d'hésitation est tel qu'une dispute a éclaté, début juin, avec Gernsbach qui a taxé son attitude de « snobisme déplacé ». Maien accepte finalement l'opportunité offerte par son ami de voir du pays et surtout de prendre un peu de distance avec New York et les soucis qui lui sont liés.
Les trois voyageurs prennent le train pour Boston le 06 juillet. Gernsbach, dont un « k » vient progressivement remplacer le « h » final et le supplantera définitivement quand Gernsback adoptera la nationalité américaine quelques années plus tard, a loué deux chambres dans un hôtel cossu de Liberty Square. Si, dans un premier temps, l'ambiance paraît joyeuse et détendue, le journal de Maien laisse rapidement entrevoir un profonde exaspération vis-à-vis de son ami, à qui il reproche une propension à se mettre constamment en valeur auprès des personnes qu'ils rencontrent, et de centrer la plupart de leurs discussions sur ses projets commerciaux. De fait, ce qui devait constituer un plaisant voyage de découverte pour de jeunes Européens ne connaissant de l'Amérique que les rues de New York, se révèle être une pénible campagne de prospection, menée par Gernsback, pour décrocher de nouveaux contrats.
Lorsque le trio arrive à Providence le 13 juillet, la tension est à son comble. Maien et Rose Harvey, dont les rapports n'ont finalement jamais dépassé le cadre de la simple courtoisie, ne s'adressent plus la parole. Gernsback, que la visite des vieux quartiers de la ville, à l'ombre des maisons victoriennes, ne motive guère, passe le plus clair de son temps à l'hôtel, en communication avec son bureau de New York pour suivre l'acheminement, depuis l'Allemagne, des pièces pour ses radios.
Le soir du 15 juillet, après un repas un peu trop arrosé au Crawford's Restaurant, une violente dispute éclate. Maien reproche à Gernsback son égocentrisme grandissant et son obsession pour l'argent qui est venue balayer toutes ses aspirations à imaginer "le monde de demain". Blessé par ces attaques, Gernsback essaye malgré tout de se justifier et de s'excuser. Il explique à son ami que si son projet l'accapare autant, c'est parce qu'il incarne précisément la volonté initiale qui les animait, lorsqu'ils étaient étudiants à Bruxelles, d'améliorer le monde, grâce à des innovations techniques. Maien, ivre et aigri, ne veut rien entendre et revient à la charge. Exaspéré, Gernsback lui demande si c'est par ses écrits d'une incroyable qualité, mais que son ego démesuré l'empêchera toujours de publier, qu'il compte changer les choses. Maien quitte le restaurant et part déambuler dans les rues de Providence, faisant escale dans plusieurs bars, avant de s'effondrer devant les grilles du vénérable Christchurch Cemetery.
Le lendemain, Maien se réveille dans sa chambre, avec une migraine monumentale. Gernsback vient le trouver. Il ne fait aucunement mention de la dispute de la veille et précise simplement que lui et Rose l'ont trouvé endormi sur le trottoir qui borde le cimetière et l'ont ramené à l'hôtel. Il explique ensuite que ses pièces sont enfin arrivées et qu'il doit retourner sans délai à New York. Maien préfère rester quelques temps pour visiter la région. Le 17 juillet, il ne se rend pas à la gare pour saluer le départ de son ami et de Rose Harvey. Charles F. Maien a déjà pris un bus qui doit le conduire, vers le Sud, à la petite ville portuaire de Kingsport.
 |
| Sunrise from Bluff Road, Kingsport (1908) |
vendredi 18 novembre 2011
Charles F. Maien : notoriété posthume d'un génie inconnu (Part.2)
Arrivés à Hoboken, Maien et Gernsbach franchissent l'Hudson et atteignent enfin l'île de Manhattan. Ils louent une petite chambre dans un hôtel de la 86ème rue. Gernsbach, qui maîtrise parfaitement l'anglais et commence à américaniser son nom en Huck Gernsbacher (clin d'œil au Huckleberry Finn de Mark Twain), cherche rapidement à nouer des contacts, afin d'obtenir un brevet pour son invention. Maien se retrouve livré à lui-même. Il tient un journal et passe le plus clair de son temps à se promener dans les rues de New York qui exercent sur lui une profonde fascination.
Trouvant lentement ses marques, Maien décide de reprendre l'écriture de son manuscrit. En avril 1904, il soumet son travail à l'éditeur du magazine Electric Stories, qu'il a rencontré par l'intermédiaire de Gernsbach. Spécialisé dans la publication d'articles de vulgarisation scientifique, cet ancêtre des pulps accepte dans ses pages quelques nouvelles de fiction, pour peu qu'elles aient un certain rapport avec le domaine scientifique, afin de toucher un lectorat plus large. Le bref roman de Maien, intitulé La dernière bataille, impressionne fortement l'éditeur.
Il s'agit d'une transposition de la bataille de Zama, qui vit s'affronter armées romaines et carthaginoises durant la deuxième guerre punique, sur la planète Sil'ana, dont le caractère désertique n'est pas sans rappeler celui de Mars ... Maien ne raconte que le siège par les forces de l'empire roon, de Zama, capitale du peuple Karth. Cependant, il le fait avec un luxe de détails d'un réalisme incroyable, une grande inventivité dans la description des machines de guerre et de la flotte interstellaire ennemie, mais surtout avec un réelle profondeur narrative. Ainsi, les chapitres proposent-ils successivement le point de vue d'Habal, général karth et défenseur de Zama, puis de son adversaire, le général roon Skipio. La description de leurs sentiments respectifs, l'un face à une défaite inéluctable, l'autre face à une victoire sanglante, sans jamais sombrer dans le manichéisme, rend les deux personnages également attachants et leurs motivations tout aussi légitimes.
S'il est convaincu par la qualité du manuscrit de Maien, l'éditeur d'Electric Stories ne peut malheureusement le publier en l'état. La dernière bataille est trop long pour entrer dans la catégorie des nouvelles, trop court pour être considéré comme un roman. Maien se voit alors proposer une publication en épisodes, à raison d'un par semaine. Il refuse catégoriquement. Gernsbach intervient auprès de son ami pour qu'il réexamine la proposition du magazine. En vain. Maien lui explique que son histoire forme un tout cohérent, qui doit être abordé comme tel : "... la découper en épisodes n'aurait pas plus de sens, à mes yeux, que de proposer la lecture d'un sonnet dont on couperait les vers, artificiellement et motivé par le seul soucis de rentabilité, après la 3ème syllabe du second quatrain. Chaque partie appelle la suivante et fait écho à celle qui la précède." (in Journal, 11 avril 1904). Le magazine est sur le point de jeter l'éponge, lorsque Maien se présente avec une autre suggestion. Aucun accord n'étant possible pour la publication de La dernière bataille, le jeune homme se dit prêt à écrire une nouvelle qui se déroulerait après la bataille de Zama et qui opposerait Habal et Skipio, derniers survivants du siège, luttant l'un contre l'autre, comme champions de leurs peuples respectifs. L'éditeur accepte. Le lendemain, Maien revient dans les bureaux d'Electric Stories avec la nouvelle intitulée Les Généraux. Elle paraît dans le numéro du 05 mai 1904, sous le pseudonyme de Fritz Mayhem. Il s'agit de l'unique publication faite par Charles Frédérick Maien de son vivant.
Charles F. Maien : notoriété posthume d'un génie inconnu
Certains auteurs n'ont pas eu la chance de connaitre la notoriété de leur vivant, Charles Frédérick Maien a tout fait pour s'y soustraire. A tel point que lorsqu'il meurt à 94 ans, aucun de ses enfants, ni petits-enfants, n'a jamais eu vent de l'activité d'écrivain que cet ancien professeur de physique a menée tout au long de sa vie, dans le plus grand secret.
Né en 1883, Charles Frédérick Maien est le second enfant d'une famille de propriétaires terriens sur le déclin qui possède un domaine à la frontière franco-luxembourgeoise. Un frère aîné, qu'il n'a jamais connu, a été tué pendant la guerre franco-prussienne de 1870 et une sœur cadette, née en 1888, meurt un an plus tard, vraisemblablement de la scarlatine. Le petit « Fritz », comme le surnomment ses parents et tous les ouvriers agricoles, mène donc une enfance solitaire, retranchée derrière les austères murailles de la demeure familiale et égaillée seulement par de longues promenades dans la campagne alentour.
Il fait son premier apprentissage auprès d'un précepteur qui l'initie à la poésie parnassienne et romantique (les œuvres de Leconte De Lisle, notamment les Poèmes barbares, et celles de Lamartine, resteront toujours pour lui une source intarissable d'inspiration) et aux sciences physiques. Son intérêt pour celles-ci est telle que ses parents acceptent de lui aménager un petit laboratoire, dans une vieille grange de la propriété. Fasciné par la lecture du Frankenstein de Mary Shelley, Maien y mène différentes expériences sur l'électricité (plus modestes que celles du célèbre baron), dont il rédige les comptes-rendus dans des fascicules abondamment illustrés par ses soins et distribués chaque Noël aux membres de la famille.
En 1899, Maien part pour Bruxelles poursuivre ses études dans un lycée privé et se lie rapidement d'amitié avec un camarade d'internat, Hugo Gernsbach. Passionné comme lui par les sciences et la spéculation scientifique, le jeune Luxembourgeois a déjà à son actif plusieurs prouesses techniques. A douze ans, grâce aux lectures de brochures commandées à Paris, il est parvenu à équiper la maison de ses parents, viticulteurs à Bonnevoie près de Luxembourg-Ville, d'un système d'interphones avec voyants lumineux. Exploit qu'il renouvelle auprès de voisins, impressionnés par son savoir-faire. Un an plus tard, un couvent des environs lui commande l'installation d'un système de sonnerie. Malheureusement, Gernsbach vient de fêter ses treize ans, l'âge de la puberté, et le couvent ne peut accepter un homme dans son enceinte. Il doit donc attendre une dispense du Pape lui-même, réclamée par son employeur, pour terminer son travail.
Les deux amis mettent rapidement en place un club scientifique : Les fils de Stéropès (d'après le nom du Cyclope, associé à l'éclair, qui contribua à la fabrication du foudre de Zeus). Le sérieux et la qualité de leurs travaux font rapidement des adeptes parmi leurs camarades et reçoivent le soutien de nombreux professeurs, jusqu'à ce qu'un fâcheux accident ne vienne y mettre un terme.
Quelques années plus tôt, l'existence de Gernsbach avait été bouleversée par la découverte du livre Mars (1895), écrit par l'astronome américain Percival Lowell, défenseur de la théorie des canaux martiens et qui consacra une grande partie de sa vie à l'étude de la planète rouge. L'ouvrage plongea le scientifique en herbe dans un état de transe qui dura deux jours, pendant lesquels il fantasma sur les prodiges d'une hypothétique technologie extra-terrestre aux possibilités infinies.
 |
| Hugo Gernsback |
Gernsbach initie Maien aux idées de l'astronome qui y trouve, lui aussi, de quoi alimenter son imagination bouillonnante. Après avoir rédigé une brochure dans laquelle ils énumèrent toutes les merveilles techniques qu'ils supposent cachés au coeur des canaux martiens, les fils de Stéropès décident de fabriquer un émetteur-récepteur qui leur permettrait d'entrer en communication avec leurs homologues de l'autre monde. Malheureusement une erreur de branchements et l'utilisation d'une batterie bien trop puissante pour leur modeste installation déclenchent un incendie qui provoque d'importants dommages dans le grenier de l'établissement et détruit une partie de la toiture. Maien et Gernsbach passent devant un conseil de discipline. Leur club est interdit et le Luxembourgeois, qui a déjà décidé de partir poursuivre ses études à l'université de Bingen en Allemagne, endosse l'entière responsabilité de la catastrophe.
Maien reste seul à Bruxelles, mais garde le contact avec son ami, par le biais d'une importante correspondance et des visites régulières en Allemagne. Pendant les trois années qui suivent, Gernsbach consacre une grande partie de son énergie à perfectionner un prototype de radio-transmetteur portatif, inspiré de celui qu'ils avaient conçu avec Maien, tandis que ce dernier se lance dans l'écriture d'un roman d' « anticipation-stellaire » (on ne parlait pas encore de space opera). Remanié à maintes reprises, le roman deviendra le premier opus de son cycle Zama.
En 1904, Gernsbach a mis au point un modèle de pile sèche, avec lequel il compte bien faire fortune aux Etats-Unis. Il convainc son ami de le suivre dans cette nouvelle aventure. Les deux hommes, Gernsbach, avec les plans de fabrication de sa pile sous le bras et Maien, avec le manuscrit inachevé de son roman, s'embarquent pour Hoboken, New Jersey.
 | |||
| Charles F. Maien, 1903 |
En 1904, Gernsbach a mis au point un modèle de pile sèche, avec lequel il compte bien faire fortune aux Etats-Unis. Il convainc son ami de le suivre dans cette nouvelle aventure. Les deux hommes, Gernsbach, avec les plans de fabrication de sa pile sous le bras et Maien, avec le manuscrit inachevé de son roman, s'embarquent pour Hoboken, New Jersey.
lundi 14 novembre 2011
Un peu d'Histoire avec oncle Ernest
Fondateur de l'histoire positiviste et figure importante de la Troisième République, Ernest Lavisse est à l'origine de manuels qui ont servi à la formation des maîtres et de leurs élèves, source d'innombrables clichés nationaux (pour l'exemple qui nous intéresse, on constatera qu'avant l'arrivée des Romains, la Gaule c'était Apocalypto ...). Témoignage d'une époque et d'une certaine vision de l'Histoire nationale, je ne résiste pas au plaisir de livrer le petit questionnaire qui accompagnait les précédentes vignettes : " Questions modèles - Comparez les n°3 et 6 (façon de faire la guerre), et les n° 1, 4, 5 (progrès des habitations) ; - Deux de ces images vous expliquent-elles pourquoi les Gaulois furent vaincus par les Romains, etc., etc."
Bon, après ... pas de quoi frimer puisqu'en Primaire (donc au début des années 80), j'ai appris l'Histoire de France grâce aux images publiées par "La Maison des Instituteurs". Images qui m'ont durablement marqué. Ici, "Le village gaulois" et "Clovis sur son pavois" (plus tard vinrent "Titan", "Strange", les aventures d'Excalibur, des Vengeurs de la Côte Ouest et celles de Spider-Man, dessinées par McFarlane, mais c'est une autre histoire).
Bon, après ... pas de quoi frimer puisqu'en Primaire (donc au début des années 80), j'ai appris l'Histoire de France grâce aux images publiées par "La Maison des Instituteurs". Images qui m'ont durablement marqué. Ici, "Le village gaulois" et "Clovis sur son pavois" (plus tard vinrent "Titan", "Strange", les aventures d'Excalibur, des Vengeurs de la Côte Ouest et celles de Spider-Man, dessinées par McFarlane, mais c'est une autre histoire).
Je reste persuadé qu'à l'époque, nous avions un manuel dans lequel étaient reproduites les affiches (accompagnées d'un texte) que l'instituteur expliquait à la classe. Je n'ai trouvé aucune trace de ce manuel sur le Web, seulement les photos des posters. Je sais que je n'ai pas halluciné, puisque je me souviens très bien de l'image "Dupleix reçoit un prince hindou" - l'affiche existe, je l'ai retrouvée ... et qui irait inventer un intitulé pareil ! - pour laquelle, précisément, nous n'avions eu aucune explication, ce qui m'avait frustré (j'aimais bien l'idée qu'un type puisse s'appeler "Dupleix" ...). Donc, si quelqu'un a une piste à me donner pour retrouver ce précieux manuel, je suis preneur. A bon entendeur ...
dimanche 13 novembre 2011
L'Homme à la caméra (1929) Dziga Vertov - Musique : Cinematic Orchestra (2003)
Je n'arrive toujours pas à me décider, concernant l'influence qu'une musique peut avoir sur la perception d'un film qui a été réalisé 74 ans avant sa composition. Je ne pourrais pas voir le film sans entendre cette musique et je ne peux pas écouter cette musique sans penser au film. C'est perturbant, mais le fait est que la symbiose fonctionne et que je ne me lasse pas de la regarder ... ni de l'écouter.
samedi 12 novembre 2011
"Frankenstein", chap. 5, Mary Shelley - traduction by Madrox
" Ce fut par une morne nuit de novembre que je pus contempler l'accomplissement de mon œuvre. J'avais rassemblé autour de moi, avec une anxiété proche de l'agonie, les instruments de vie, afin d'insuffler une étincelle de conscience dans la chose inerte qui gisait à mes pieds. Il était déjà une heure du matin, la pluie battait, lugubre, contre les carreaux de la fenêtre et ma bougie était presque consumée, lorsque dans la lueur de la flamme vacillante, je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de la créature. Elle respirait avec peine et un mouvement convulsif parcourait ses membres.
Comment pourrais-je décrire mes émotions devant cette catastrophe ? Comment dépeindre le misérable à qui j'avais donné forme, au prix d'efforts et de soins infinis ? Ses membres étaient bien proportionnés et j'avais choisi ses traits pour leur beauté. Leur beauté, grand Dieu ! Sa peau jaune couvrait à peine la ligne de ses muscles et la forme de ses artères, sa chevelure ondoyante était d'un noir de jais, ses dents d'un blanc nacré. Mais cette abondance venait seulement former un contraste des plus épouvantables avec son teint flétris, ses lèvres noires et droites et l'humeur aqueuse de ses yeux qui semblaient presque de la même couleur que les orbites d'un brun sombre marbré de blanc, dans lesquelles ils étaient sertis.
 |
| Illustr. Bernie Wrighston |
Les divers accidents de l'existence ne sont pas aussi versatiles que les sentiments de la nature humaine. J'avais travaillé dur pendant presque deux années, avec pour seul but d'insuffler la vie à un corps inanimé. Pour ce faire, je m'étais privé de repos et avais sacrifié ma santé. Mon désir atteignait une ardeur qui excluait toute modération. Maintenant que tout était terminé, la beauté du rêve s'évanouissait et une horreur, un dégoût, sans nom emplissaient mon cœur. Incapable de supporter l'apparence de l'être que j'avais créé, je me précipitai hors de la pièce et arpentais ma chambre, sans parvenir à me ressaisir, ni à trouver le sommeil.
Finalement, la lassitude succéda à l'agitation que j'avais auparavant endurée. Je me jetai sur le lit tout habillé et fis de mon mieux pour trouver un bref moment d'oubli, en vain. Je dormis, pour sûr, mais mon sommeil fut perturbé par les rêves les plus fous. Je crus voir Élisabeth, resplendissante de santé, marcher dans les rues d'Ingolstadt. Ravi et surpris, je la pris dans mes bras, mais comme je posai sur ses lèvres un premier baiser, celles-ci devinrent livides et se parèrent du voile de la mort. Ses traits semblaient changer, et je crus tenir dans mes bras la dépouille de ma mère, enveloppée d'un linceul, dans les plis duquel je vis ramper des vers. L'horreur me réveilla en un sursaut. Une sueur froide couvrait mon front, mes dents claquaient et tous mes membres se mirent à trembler. C'est alors que, par la faible lueur jaunâtre de la Lune, comme elle se frayait un passage à travers les persiennes, je contemplai le pauvre diable – le misérable monstre - que j'avais créé. Il avait relevé le rideau du lit et ses yeux, s'il est permis de parler d'yeux, étaient fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvrirent et il marmonna quelques sons inarticulés, tandis qu'un rictus déformait ses joues. Peut-être parla-t-il, mais je ne l'entendis pas. Une main était tendue, manifestement pour me retenir, mais je m'enfuis et dévalai les escaliers. Je me réfugiai dans la cour de ma maison où je demeurais pour le reste de la nuit, faisant les cents pas, en proie à la plus grande agitation, écoutant avec attention et redoutant, au moindre son, de voir s'approcher le corps démoniaque auquel j'avais si misérablement donné vie. "
jeudi 10 novembre 2011
Arzak Raphsody by Moebius
Créé par Moebius en 1975 dans Métal Hurlant, Arzak est devenu un personnage récurrent dans l'oeuvre du dessinateur. Voici le premier épisode de la série animée, conçue entièrement par son créateur. Le résultat est minimaliste, mais respecte bien, à mon sens, l'univers de la bande dessinée originale (même si j'aime pas la voix-off).
Je rajoute une séquence d'"El Topo" de Jodorowsky, dont l'ambiance surréaliste et dépouillée, même si elle renvoie au western-spaghetti (le film date de 1970, l'influence de Leone est digérée), m'a toujours fait penser aux trips métaphysico-désertiques de Moëbius (qui lui viendraient d'un voyage, sous influence, au Mexique).
Dans la mesure où les deux bonhommes ont travaillé par la suite sur "L'Incal", un projet d'adaptation de "Dune" et que Moëbius participaient aux séances du type "Cabaret mystique" organisées par Jodorowsky, leurs univers me semblent suffisamment liés, au moins visuellement, pour justifier la mise en commun de ces deux extraits.
Je rajoute une séquence d'"El Topo" de Jodorowsky, dont l'ambiance surréaliste et dépouillée, même si elle renvoie au western-spaghetti (le film date de 1970, l'influence de Leone est digérée), m'a toujours fait penser aux trips métaphysico-désertiques de Moëbius (qui lui viendraient d'un voyage, sous influence, au Mexique).
Dans la mesure où les deux bonhommes ont travaillé par la suite sur "L'Incal", un projet d'adaptation de "Dune" et que Moëbius participaient aux séances du type "Cabaret mystique" organisées par Jodorowsky, leurs univers me semblent suffisamment liés, au moins visuellement, pour justifier la mise en commun de ces deux extraits.
mardi 8 novembre 2011
lundi 7 novembre 2011
dimanche 6 novembre 2011
"Atypique", disait la jaquette
Double-programme épouvante hier soir, pour rester en accord avec la météo du weekend. Suis allé piocher dans la pile de DVD "en attente", dégotés à 0,50 centimes dans les solderies et j'ai enfin pris le temps de savourer Halloween III : Season of the Witch (1982) de Tommy Lee Wallace et The Terror (1963) de Roger Corman.
Rien à redire sur le premier film, resté dans les annales de la franchise Halloween pour être le seul à ne pas faire intervenir son tueur emblématique Michael Myers. On notera que ce dernier apparaît malgré tout en photo, au dos de la jaquette, accompagné de l'accroche mensongère de l'éditeur : "Michael Myers ne tuera plus, il est guéri ... enfin presque !". Ce petit film, à la réalisation soignée (Wallace tournera plus tard Fright Night II et Ca, l'adaptation du roman de Stephen King ... rien d'impérissable en somme, mais rien de honteux), aux meurtres rares, mais sanglants, et à l'ambiance tendue, nous rappelle qu'à la fin des 70's et au début des 80's, on savait produire des séries B horrifiques bien troussées.
Une semaine avant la fête d'Halloween. Le propriétaire d'une petite boutique de farces et attrapes, qui serre dans ses bras un masque en forme de citrouille, est admis dans un hôpital avant d'être violemment assassiné. Son meurtrier, un homme impassible vêtu d'un complet gris, regagne sa voiture et s'immole. Accompagné de la fille de la victime, le docteur Dan Challis mène l'enquête et se retrouve dans la petite ville de Santa Mira (lieu de l'action de L'Invasion des profanateurs de sépultures (1956) de Don Siegel, dont le héros est aussi un médecin. Petit hommage en passant), où les habitants semblent complètement dominés par la personnalité de Conal Cochran, le directeur de la fabrique de jouets Silver Shamrock ...
John Carpenter officie sur le projet en qualité de producteur et de compositeur (ce qu'il est depuis le premier opus, dont il a créé le thème musical incontournable). A l'époque, il souhaite faire d'Halloween une série de films aux histoires indépendantes, ayant pour seul point commun la fameuse nuit qui précède la Fête des Morts. Halloween III et son enquête sur une étrange fabrique de masques ouvre le bal, pour le clore aussitôt. L'échec du film va remettre à l'endroit la tête des investisseurs et Michael Myers de revenir ... et revenir ... et revenir encore, dans des productions à la qualité souvent douteuse, avant que deux remakes, réalisés par Rob Zombie en 2007 et 2009 (et sujets à polémique, mais c'est une autre histoire), ne viennent redynamiser ses aventures.
Ajoutons enfin que l'intrigue d'Halloween III, qui mélange éléments scientifiques et occultisme ; les inquiétants "hommes en gris", chargés de veiller sur la fabrique de masques, et leur démarche d'automates ; le complot mis en place par un savant fou ... ne sont pas sans rappeler les aventures télévisuelles, puis cinématographiques, du professeur Quatermass. Et pour cause ! L'écriture du scénario a été confiée par Carpenter à Nigel Kneale, créateur de la série Quatermass pour la BBC, dont il admirait la qualité au point de signer certains de ses propres scénarios, celui de Prince des ténèbres notamment, du pseudonyme de Martin Quatermass.
En comparaison, The Terror avec Boris Karloff (sur la fin) et Jack Nicholson (pas encore pourvu de son front légendaire) constitue un joli petit ovni foutraque, assez représentatif du bordel qu'a pu devenir la réalisation de certaines séries B des 60's.
Produit par Roger Corman - l'homme qui a lancé Martin Scorsese, Denis Hopper, James Cameron, Robert De Niro, William Shatner et Patachou - ce dernier n'a filmé que les plans avec Karloff, et quelques plans complémentaires, en espérant leur donner un sens plus tard. On n'est pas si loin, toutes proportions gardées, d'une organisation à la Ed Wood, qui faisait tourner des prises sans queue ni tête, à un Bela Lugosi au bout du rouleau. A ce niveau, certaines scènes de The Terror donnent vraiment l'impression que Karloff, perdu dans une intrigue en roue libre, fait du mieux qu'il peut pour rester crédible.
La réalisation a ensuite été reprise par Francis Ford Coppola (originellement crédité comme "assistant de production"), Monte Hellman (futur réalisateur de Two-Lane Blacktop), Jack Hill (futur réalisateur de Foxy Brown avec Pam Grier et autres films de blaxploitation) et Jack Nicholson lui-même. Dans le genre équipe de prestige, on aura rarement vu mieux, mais pour quel résultat ... Avec un plan de travail inexistant, pas de moyens et un tournage fait à l'arrache, il est difficile d'aboutir à un chef d'oeuvre.
Que retenir de cette histoire d'officier de l'armée napoléonienne, André Duvalier (Nicholson, qui se débrouille presque trop bien, vu le contexte), perdu dans une campagne prussienne qui ressemble fort au littoral californien (pour cause), et "se retrouve malgré lui l'hôte indésirable du Baron Von Leppe (Karloff), lequel va tenter de lui dissimuler l'horrible vérité qu'abritent les murs de son sinistre château", comme le résume si bien la jaquette ? Et bien ... précisément le charme désuet, assurément ringard, mais néanmoins authentique, de ces productions horrifiques. Charme auquel participent précisément les incohérences de montage ou la platitude des dialogues, et d'où surgissent toujours, quand on s'y attend le moins, un plan, voire une scène si l'on a de la chance, parfaitement aboutis et qui nous feront admettre, après coup, qu'il y a quand même deux ou trois bonnes choses à garder là-dedans !
vendredi 4 novembre 2011
Cthulhu, Han Solo & les Cramps
Il n'aura échappé à personne (... long silence méditatif ...) que pour l'instant ce blog ressemble surtout à une page améliorée de Facebook sur laquelle je posterais des vidéos ou des liens vers des sites qui me plaisent, sans avoir à me farcir le mur des lamenta(ble)tions, mais sans véritables analyses. Comme j'ai pu l'expliquer de vive voix à certains, cet état de fait est dû à ma découverte des possibilités offertes par le blog (capacité des vidéos exportables, mise en page des textes, usw ...).
Pour la suite, l'idée est la suivante : garder le concept de mise en ligne régulière de vidéos, textes, liens ... faite à l'arrache, selon l'humeur et les trouvailles (je triche un peu ... il y en a plusieurs d'avance). Mais une fois par mois, publication d'un article de fond, parce que, quand même, ça prend du temps de lire les livres et les articles. Celui de novembre sera donc consacré à L'Appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Celui de décembre, devrait porter sur John Brown, un abolitionniste fanatique américain. J'adore les sujets d'actualité qui captivent tout le monde !
Ma problématique de départ, pour Lovecraft, était de m'interroger sur la notoriété de cette nouvelle, que je trouve bonne, mais pas ..., par rapport à d'autres, écrites à la même période. Après relectures de la nouvelle et d'ouvrages sur Lovecraft, j'ai décidé de partir sur une ligne différente, plus comparatiste : L'Appel ... et les nouvelles qui l'ont précédée - mais liées au mythe de Cthulhu - à savoir : Dagon, Nyarlathotep, La Cité sans Nom, Le Molosse, Azatoth, Le Festival et Le Descendant (encore que pour celle-là, il y a discussion sur la date d'écriture). En gros, expliquer comment Lovecraft en est arrivé là (littérairement), puis, si le temps me le permet, analyser l'influence de L'Appel... sur la culture actuelle (jeux de rôles, musique, bande-dessinée, cinéma ...).
Qu'on soit bien d'accord, mon but n'est pas de produire une thèse sur le sujet. De nombreux critiques ont parlé, et parlent de Lovecraft, mieux que je ne pourrais/voudrais le faire (je vous donnerai les liens). L'objectif est de me fournir un axe de lecture pour réaborder certaines de ses oeuvres, dont L'Appel... (ça, c'est fait !) et, par le biais de mes articles, de donner, je l'espère, l'envie à ceux qui ont laissé H.P. dans un coin de leur tête depuis trop longtemps, ou ceux qui ne s'y sont jamais frottés, de franchir les portes de R'lyeh et de découvrir cet auteur majeur du XXème siècle.
Bon, comme je vous ai tenu la jambe avec mes explications et que j'aimerais bien justifier le titre de mon article, voici l'aventure qui montre pourquoi Jabba recherche Han Solo, depuis le début de la 1ère trilogie, et la nature de la fameuse "cargaison" qu'il a perdue. La vidéo date de l'an dernier, est faite par des amateurs, mais c'est calidad !
Cette version vient de Youtube, mais je l'ai découverte en cherchant les plans du Firefly (oui, le vaisseau de la trop brève série de Joss Whedon), sur l'excellent blog Les Echos d'Altaïr dont je recommande chaudement la visite.
Voilà ... après Lovecraft, Star Wars et la quête des schémas d'un vaisseau de série télé, il ne reste plus qu'à se délecter de l'excellentissime Can Your Pussy Do The Dog ? des Cramps, avant d'aller se coucher.
mercredi 2 novembre 2011
La Voix de notre Maître
Durant l'été 1997, l'agence américaine d'étude de l'océan et de l'atmosphère (N.O.A.A.) a enregistré à plusieurs reprises dans le Pacifique Sud, des sons d'ultra-basse fréquence, rebaptisés plus scientifiquement ... bloop. L'origine de ce bloop n'a jamais pu être déterminée avec certitude : baleine bleue gigantesque, calamar géant, sous-marin purgeant ses ballasts ... ? Les scientifiques se perdent en conjectures. Il ne leur aura toutefois pas échappé que les coordonnées du point d'émission du bloop le situent dans une zone proche du point Némo (le plus éloigné de toute terre émergée), zone qui avait connu, en 1925, une intense activité sismique sous-marine. Ce phénomène a été mis en lumière par l'éminent investigateur de l'occulte, H.P. Lovecraft, dans son oeuvre de vulgarisation : L'Appel de Cthulhu. L'écrivain y relate, sous la forme d'une brève nouvelle, plus acceptable à la frilosité de l'esprit humain, la rencontre entre l'équipage d'un navire, perdu dans une terrible tempête, et le monstrueux dieu Cthulhu dans la cité impie de R'lyeh.
C'est alors que poussés par la curiosité, les hommes poursuivirent leur route sous la direction de Johansen dans le yacht qu'ils avaient capturé, aperçoivent un grand pilier de pierre qui sort de la mer et, par 47° 9' de latitude sud et 126° 43' de longitude ouest, tombent sur une côte faite de boues mêlées, de vase et d'une maçonnerie cyclopéenne, couverte d'algues, qui ne peut être que la substance tangible de la suprême terreur de la terre - la cité aux corps morts, la cité de cauchemar, R'lyeh, bâtie depuis des éons infinis, avant que toute histoire ne commence, par les formes immenses et repoussantes venues de sombres étoiles qui s'étaient infiltrées sur la terre. C'est là que repose le grand Cthulhu et ses hordes, cachés dans des tombes vertes et gluantes.
L'Appel de Cthulhu, H.P. Lovecraft (1926) trad. Claude Gilbert, in Lovecraft, Tome 1 - Bouquins, Robert Laffont
Le bloop ne serait-il pas simplement un soupir poussé par le Grand Ancien, dans le sommeil éternel de sa tombe marine, tandis qu'il rêve du jour où les astres seront enfin propices au retour de sa race ... ?
mardi 1 novembre 2011
Steamboat Story
Sorti en 1928, Steamboat Willie est considéré, au vu de son succès, comme la véritable naissance de Mickey Mouse, même si le personnage est déjà apparu, un an plus tôt, dans Plane Crazy et The Gallopin' Gaucho.
Le film constitue également une date importante dans l'histoire du cinéma, pour son utilisation de la technique du son synchronisé, à une époque où le procédé est encore balbutiant (The Jazz Singer d'Al Cosland, premier film à intégrer des scènes de chansons et de dialogues, date de 1927).
Parodie du film Steamboat Bill Jr. (Cadet d'eau douce en français) de Buster Keaton et Charles Reisner, sorti trois mois plus tôt, le dessin-animé de Disney reste une source d'inspiration régulièrement citée par les cinéastes et créateurs actuels (qu'on pense, par exemple, à la première aventure d'Itchy & Scratchy, dans Les Simpson, qui s'intitule Steamboat Scratchy et se déroule sur un vapeur …).
En 1994, pour célébrer les 65 ans de Mickey, est sorti sur Super NES, Mickey Mania : The Timeless Adventures of Mickey Mouse. Le jeu, toujours considéré comme un petit bijou vidéo-ludique, revisite les temps forts de la carrière du personnage. Son premier niveau est naturellement un hommage à Steamboat Willie.
Histoire de réunir toute la famille, je rajoute Dinner Time de Paul Terry, premier film d'animation à utiliser le son synchronisé, un mois avant Steamboat Willie.
De l'arbre à la feuille
Le blog Golden Age Comic Book Story propose un collection hallucinante de couvertures de vieux comics, pulps (Weird Tales ...), affiches de films noirs, fantastiques et d'épouvante, goodies (badge Captain Marvel, calendrier Betty Page...). Les scans sont tous de qualité et permettent d'apprécier pleinement la beauté des illustrations. On trouve également plusieurs bandes dessinées intégrales, notamment un épisode de Twilight Zone, et surtout l'unique numéro de Abyss, magazine publié en 1970, dans la tradition d'EC Comics, auquel participèrent Berni Wrighston, Michael Kaluta, Bruce et Jeff Jones. De quoi s'occuper et fouiner pendant un bon moment.
Cliquer sur Betty Boop pour rejoindre la caverne aux merveilles.
Cliquer sur Betty Boop pour rejoindre la caverne aux merveilles.
Le blog est tenu par un certain Mr. Door Tree, dont l'une des autres passions s'exprime dans un second blog, où il présente des photos, prises sous tous les angles et en toutes saisons, d'un seul et même arbre qu'on imagine se trouver près de chez lui : le fameux "Door Tree" (ou Arbre-Porte). C'est farfelus, mais je trouve la démarche assez poétique ...
Inscription à :
Commentaires (Atom)